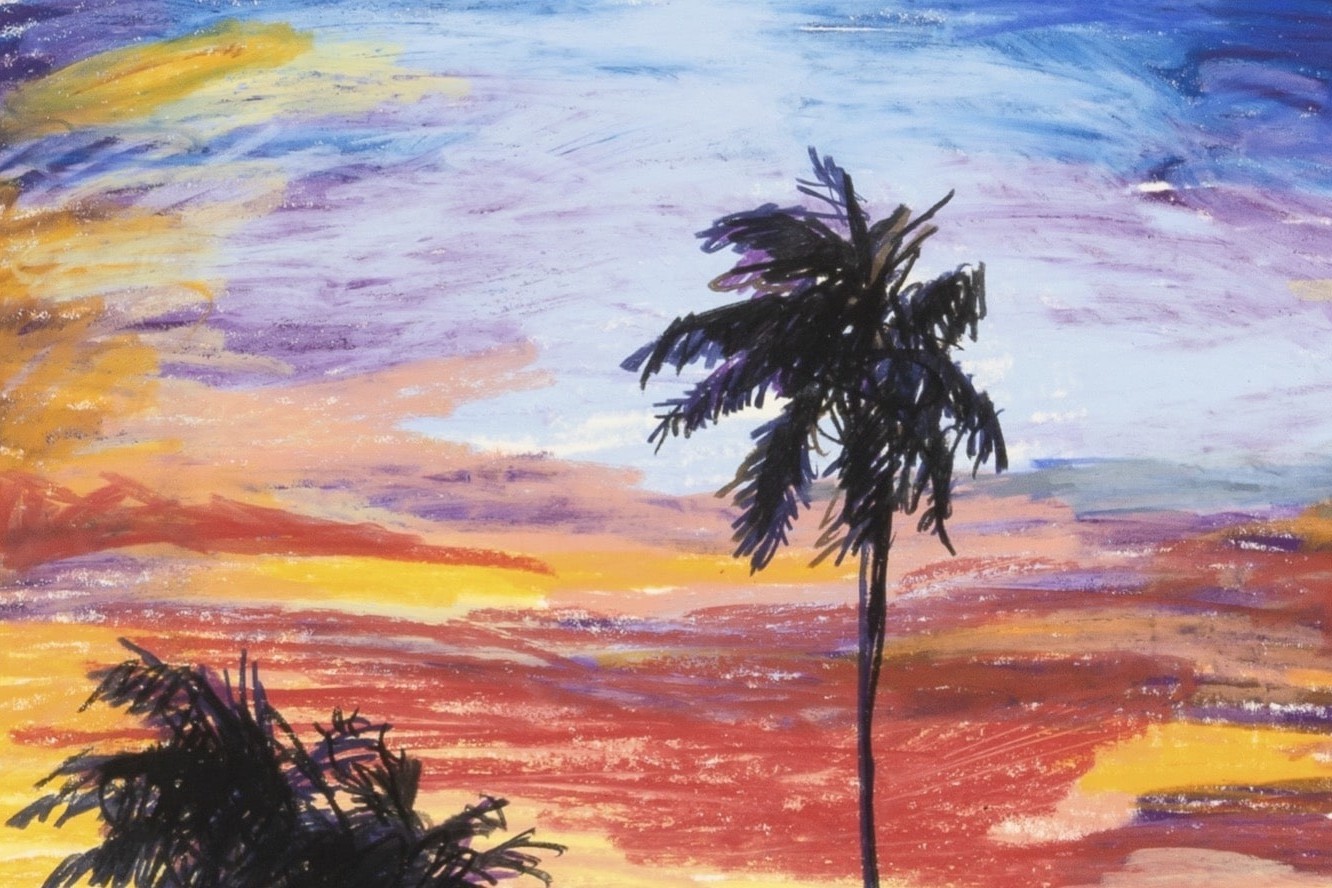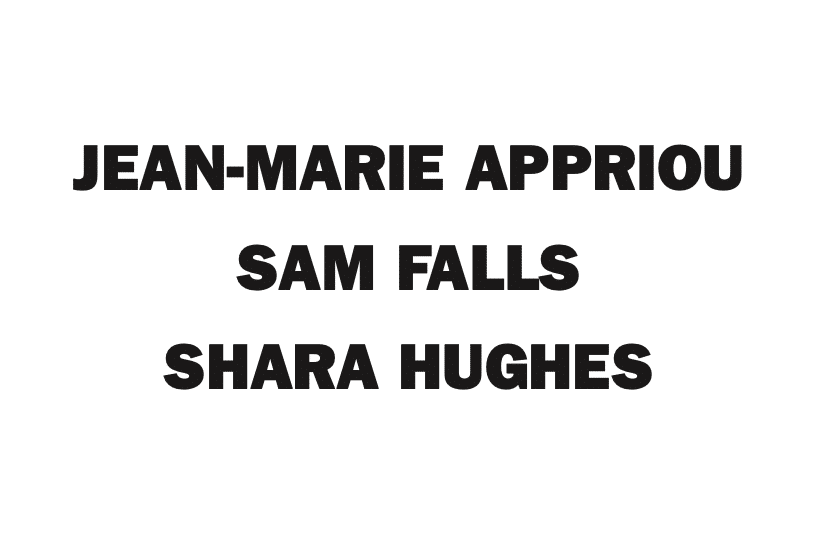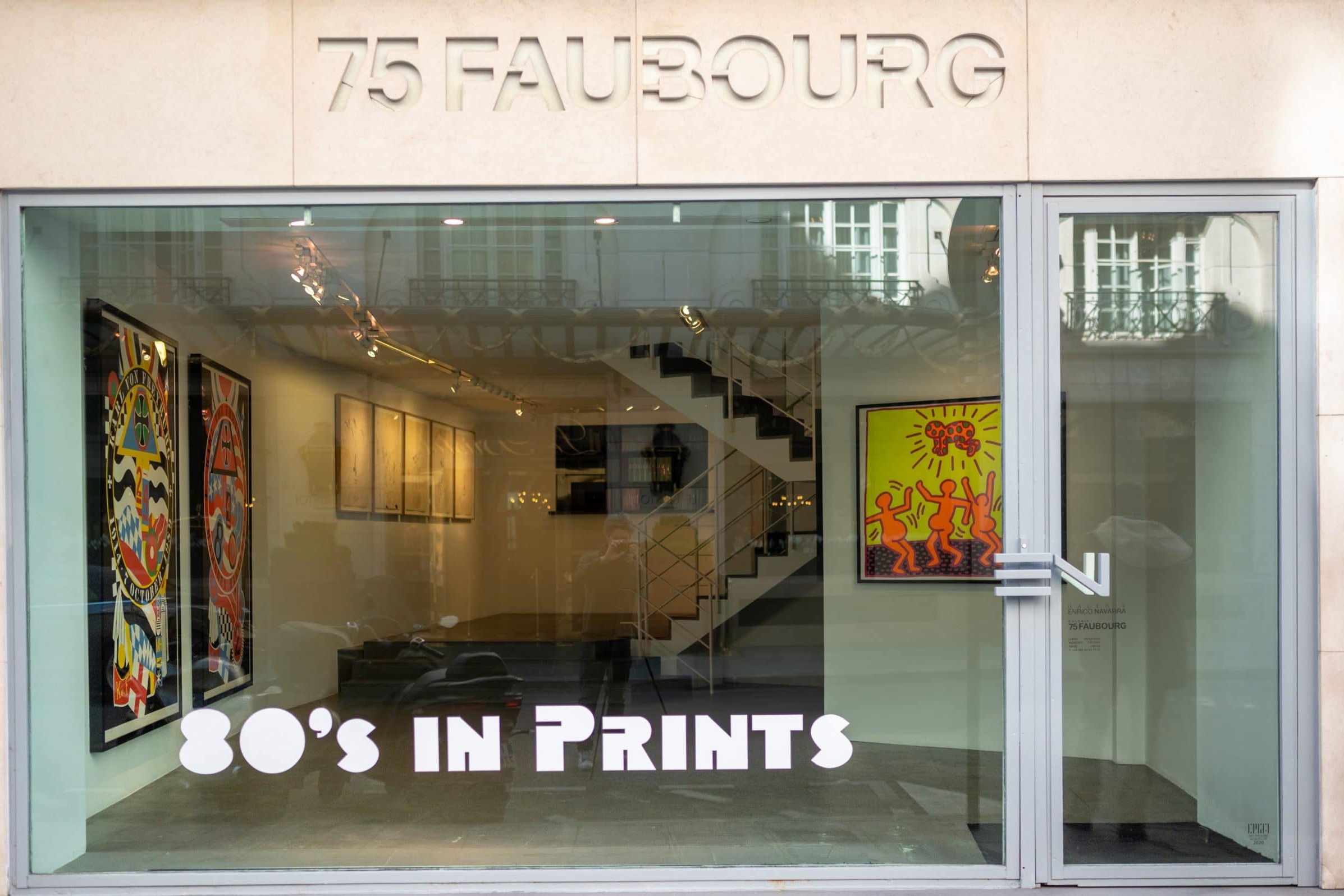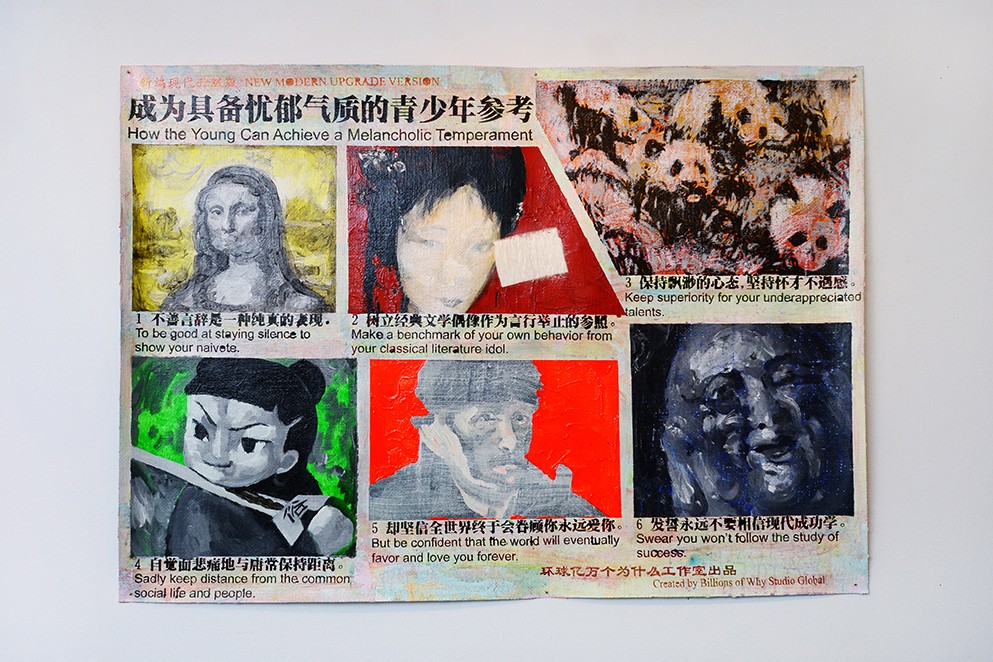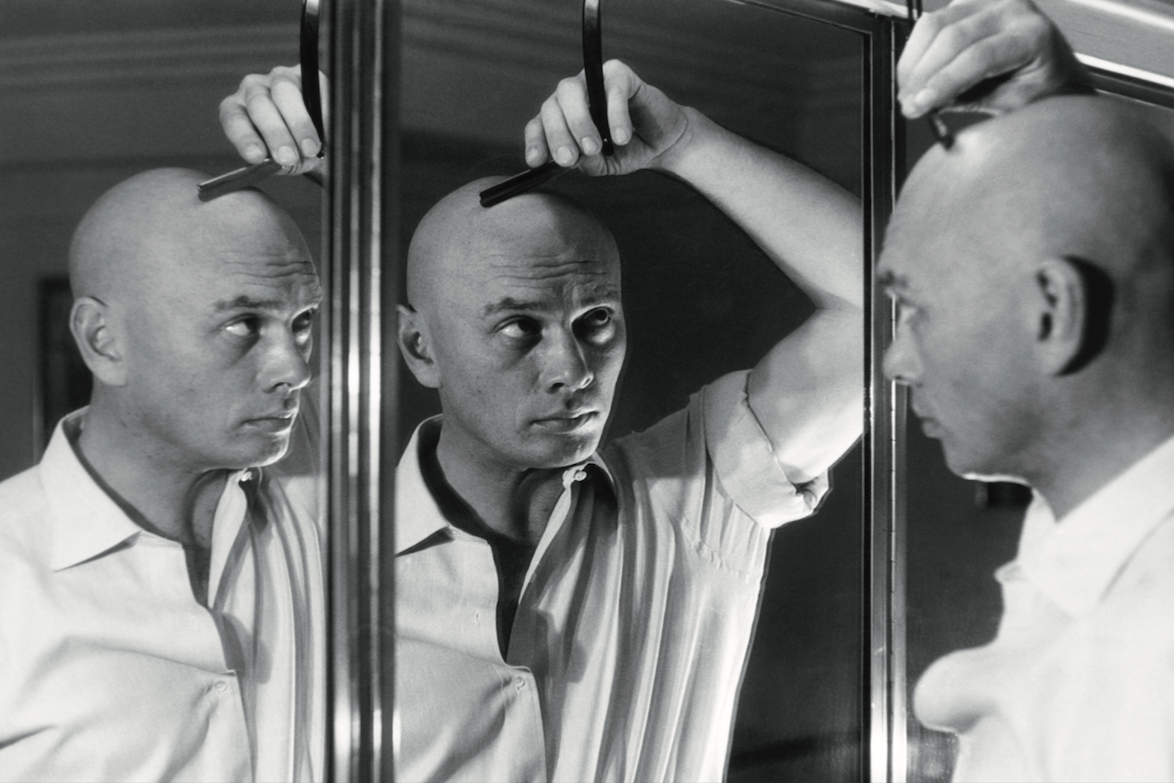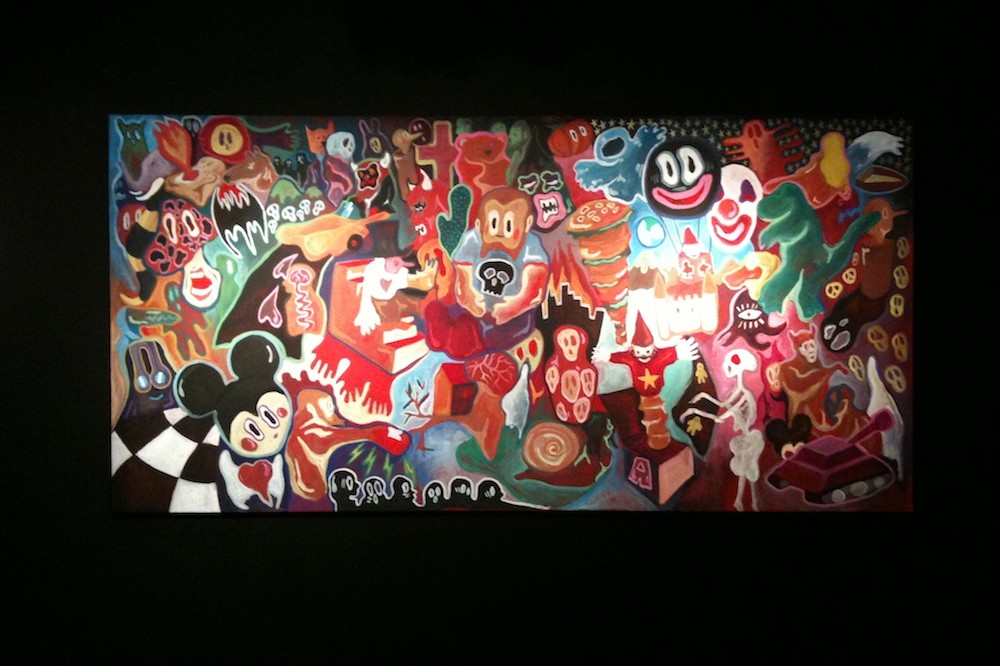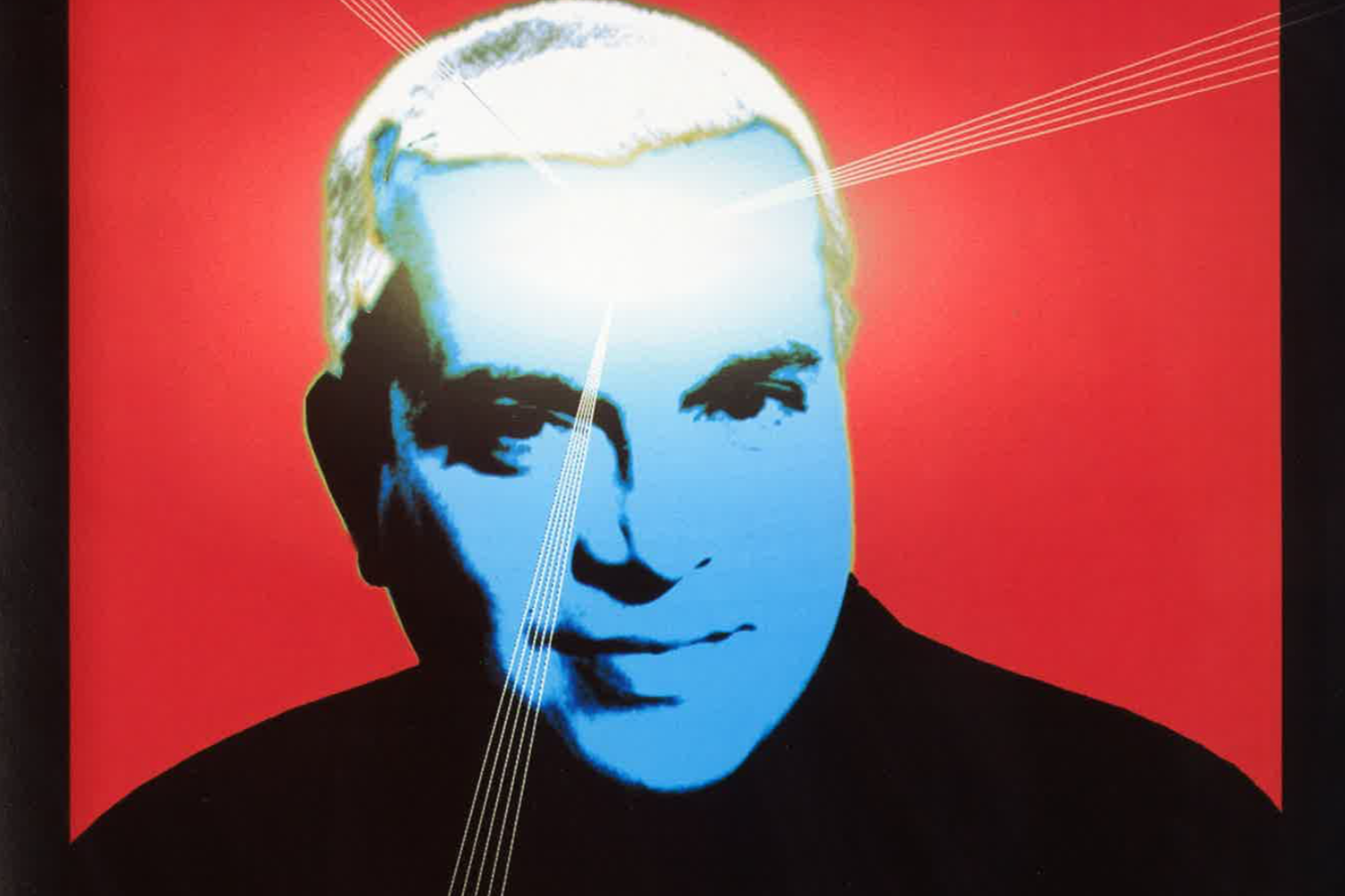Yuree Kensaku. « Le Mont Never-Rest »
21.10.2025 – 30.01.2026
Louisa Gagliardi. « Hard-Pressed »
04.09.2025 – 07.10.2025
Matt McCormick. « Running On Empty »
27.06 – 01.08.2025
Makoto Ofune. « Eternity »
30.04.2025 – 13.06.2025
« Keith Haring, Techno-Primitive Iconography »
16.10.2024 – 14.12.2024
Brandon Deener. « Résonance »
28.06.2024 – 01.10.2024
Alec DeMarco. « The Beast and the Boy »
17.05.2024 – 21.06.2024
Ronnie Cutrone
22.03.2024 – 10.05.2024
« MAO »
21.02.2024 – 15.03.2024
Renk. « Paper Cloud »
08.12.2023 – 09.02.2024
Enoc Pérez. « Under the Palm Trees »
18.10.2023 - 01.12.2023
Dr. Esther Mahlangu. « The Breath of Calligraphy »
21.04.2023 – 02.06.2023
05.06.2023 - 30.06.2023
Renk. « Voyages sur le motif »
27.01.2023 – 24.03.2023
27.03.2023 - 07.04.2023
Amanda Sthers. « Le lendemain, tout a changé »
02.12.2022 – 13.01.2023
« HARPER’S x 75 FAUBOURG »
18.10.2022 – 18.11.2022
Inès Mélia. « Ne Me Retiens Pas »
09.09.2022 – 07.10.2022
Rafa Macarrón
09.06.2022 – 08.07.2022
« Meet Purvis Young »
01.04.2022 – 22.05.2022
Djamel Tatah – Zoulikha Bouabdellah
01.02.2022 – 23.03.2022
« Catch Them All ! »
10.12.2021 – 24.12.2021
03.01.2022 - 16.01.2022
Enoc Pérez
22.10.2021 – 03.12.2021
Jean-Marie Appriou, Sam Falls, Shara Hughes
01.09.2021 – 29.09.2021
Guggi. « Time »
17.06.2021 – 30.07.2021
« Sur les Traces de Penck »
27.04.2021 – 21.05.2021
« 80’s IN PRINTS »
19.02.2021 – 09.04.2021
« Beyond Black & White »
22.10.2020 – 18.12.2020
« galerie frank elbaz @ 75 FAUBOURG »
25.02.2020 – 14.04.2020
Kenny Scharf. « Paradis Perdu »
20.10.2018 – 21.12.2018
Jean Prouvé – Jean-Michel Basquiat – Keith Haring
17.09.2018 – 18.10.2018
Simon Schwyzer. « Constellation »
13.04.2018 – 12.06.2018
« London Calling »
17.11.2017 - 15.12.2017
Amos Gitaï. « Coup d’État »
20.04.2017 – 02.06.2017
Zhang Lehua. « The Interpreter who Interrupts »
08.01.2015 – 07.02.2015
Enrico Dagnino. « #Untitled »
29.10.2015 – 11.12.2015
« Tribute to Hanart TZ Gallery »
24.10.2014 – 27.11.2014
Qiu Anxiong. « E-motion »
27.05.2014 – 30.06.2014
Rudy Ricciotti. « Éléments d’architecture »
28.05.2013 – 31.06.2013
Benoît Gysembergh. « La photo en première ligne »
27.11.2013 – 13.12.2013
Jack Garofalo. « 40 ans de photojournalisme »
14.11.2012 – 01.12.2012
Fabien Verschaere. « Sweet Inspiration »
05.02.2010 – 05.03.2010
Jean Prouvé
12.02.2009 – 21.03.2009
Mahi Binebine
16.04.2008 – 17.05.2008
Liu Guosong
04.03.2008 – 26.03.2008
Zhao Guanghui
07.02.2008 – 01.03.2008
Stephane Graff. « Black Box »
10.05.2007 – 02.06.2007
Baba Anand
21.03.2007 – 21.04.2007
Qiu Shihua
01.12.2006 – 31.12.2006
Yue Minjun. « Manipulation »
26.10.2006 – 25.11.2006
Hung Tung-lu
15.09.2006 – 18.10.2006
Chao Chung-Hsiang
02.06.2004 – 31.07.2004